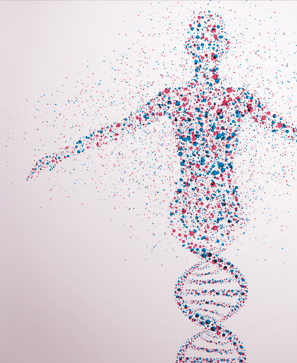Nous vivons une crise d’une ampleur sans précédent, en majeure partie parce que nous continuons à vivre selon des concepts dépassés. Vous affirmez que les lueurs du présent proviennent d’un astre mort, celui des croyances du XIXᵉ siècle, obscurcies par les tragédies du siècle suivant. Que voulez-vous dire ?
Je parle sans équivoque des croyances qui fabriquent notre vision actuelle du monde, issues d’une évolution linéaire des sociétés humaines libérales et industrielles, ce progrès irréversible dû aux sciences, aux techniques et aux industries. Cette conception d’un temps linéaire et mécanique orienté comme une flèche vers l’avenir est propre aux sociétés modernes industrielles, dominées par des notions de sélection, de compétition, de progrès continu... C’est un mirage dangereux, comme le montre notre histoire récente. Si Albert Camus a parlé du «
siècle de la peur » pour le XX
e siècle, nous pourrions évoquer un « siècle de la terreur » avec le XXI
e siècle, celui des catastrophes climatiques, sanitaires et politiques. Elles sont liées à la surexploitation des ressources naturelles et humaines qui conduit à une modification de notre écosystème, avec les désordres que nous connaissons aujourd’hui. La pandémie a mis en évidence que notre modèle de société n’est pas construit sur un socle ferme, solide.
Vous dénoncez un déséquilibre majeur entre le progrès et la sagesse requise, face à nos découvertes. Quel est-il ?
Ce déséquilibre est de l’ordre de la morale, un point essentiel dont j’aimerais vous parler. Cette course aveugle du progrès technique et industriel a conduit à un déséquilibre abyssal entre les moyens déployés pour maîtriser et exploiter l’environnement, naturel et humain, et notre responsabilité morale à l’égard de la nature, des autres espèces, finalement de nous-mêmes, les humains. Ce modèle est parvenu à transformer tous les organismes vivants en « organisations » fonctionnelles et instrumentales, et au final à traiter les hommes comme des choses. Au nom de l’efficacité, tout est transformé en machines, humains compris. L’organisation tayloriste du travail est à la fois le symptôme et l’opérateur le plus significatif de cette vision du monde de nos sociétés industrielles. En échange de cette aliénation aux techniques et aux bureaucraties, on fait croire aux humains qu’ils sont libres et autonomes. Mais libres de quoi ? De s’exploiter eux-mêmes telles des microentreprises autogérées ouvertes à la concurrence et à la compétition sur le marché des existences ! Et c’est là qu’intervient la question essentielle de la morale, qu’il nous faut absolument nous poser. Une morale peut-elle être fondée sur la concurrence et la sélection des meilleurs dans le mépris des plus faibles ? Comment la morale collective pourrait-elle se déduire d’une culture de la concurrence, de la sélection des meilleurs, du mépris de la vulnérabilité et des valeurs négatives du manque et de la tristesse, qui conditionnent pourtant l’amour et la fraternité et nous conduisent à devoir reconnaître l’altérité comme essentielle ? Il faut retrouver la vraie liberté qui est celle de penser, de dire et de créer ensemble, la liberté des Anciens qui ont inventé la démocratie. Nous devons pour cela réhabiliter la valeur de la parole, écrasée aujourd’hui par les chiffres qui deviennent le moyen de soumettre et de donner les ordres, comme c’est le cas pour cette pandémie.
Qui est Roland Gori ?
Psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie clinique à l’université d’Aix-Marseille, il est l’initiateur de l’Appel des appels, pour une insurrection des consciences. Dans les années 2000, il signe plusieurs livres prophétiques : La santé totalitaire : essai sur la médicalisation de l’existence (éd. Flammarion, 2009) et Exilés de l’intime : la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique (éd. Denoël, 2008).
D’où la nécessité urgente d’un recours vital à la sagesse que vous évoquez ? Peut-on faire un parallèle avec la phrase de Malraux : « Le XXIᵉ siècle sera spirituel ou ne sera pas » ?
La globalisation marchande a évacué la dimension spirituelle du monde, comme l’avait prédit André Malraux. Alors, oui, nous avons un besoin urgent de sagesse, de spiritualité, de littérature, de fiction et d’art. «
Nous avons besoin de l’art pour ne pas périr de la vérité », écrivait Nietzsche, en parlant de la vérité de la science et de sa méthode. Nous vivons dans un monde désenchanté, comme le nommait Max Weber, économiste et sociologue allemand, désacralisé, étouffé par des rationalisations techniques et économiques morbides. Nous aboutissons à un utilitarisme effréné, «
un monde sans esprit », l’appelait Marx. Ce monde technicisé, taylorisé, industrialisé conduit à une «
obsolescence de l’homme » (selon le philosophe Günther Anders). En effet, ce type de pouvoir exige une adaptation en « marche forcée » des humains particulièrement cruelle, et produit non seulement une misère matérielle par les inégalités sociales et nationales, mais aussi une misère symbolique qui touche toutes les classes sociales et les pays. Comme nous pouvons le voir aujourd’hui. Or Léon Tolstoï comme Walter Benjamin, chacun à leur façon, ont montré que les peuples sont assoiffés d’art, de fictions, de folklores, de traditions, de contes et de récits, pour pouvoir faire le « lien social ».
Aristote disait déjà que les hommes se réunissaient pour construire des cités, pas seulement à cause des intérêts matériels que la communauté leur apportait, mais aussi parce qu’ils avaient besoin de se reconnaître les uns les autres. C’est la
philia, l’amitié qui les pousse à être ensemble. La raison qui guide le monde ne peut pas être seulement la rationalité pratique (la raison des affaires) et la rationalité formelle (la pensée du droit et de la norme). Nous avons besoin de « rationalité substantielle », de morale et de religions (fussent-elles laïques), nous avons besoin de littérature et d’œuvres qui nous permettent de créer notre vie comme une œuvre d’art, dixit Michel Foucault, de produire une esthétique des existences. Nous ne pouvons en aucun cas nous en tenir aux principes fondateurs de nos sociétés thermo-industrielles, résumés par le slogan de l’Exposition universelle de Chicago en 1933 : « La science trouve, l’industrie applique, l’homme s’adapte. »
Pour dépasser le traumatisme de la pandémie, vous proposez un travail de deuil. De quoi parlez-vous ?
Il faut repenser en premier lieu ce qu’est le traumatisme : il résulte non seulement du choc mais aussi de l’état d’impréparation de l’organisme qui le reçoit, que ce soit le sujet singulier ou collectif. La névrose traumatique et le stress post-traumatique ne résultent pas de la violence du choc mais de l’état de sidération de celui qui les reçoit, de l’intrusion psychique et de la fragmentation du psychisme qui s’ensuit. Le biologiste évolutionniste Jared Diamond a montré par une analyse comparative des sociétés que leur effondrement ne résultait pas seulement des facteurs environnementaux, mais également de leurs organisations sociales. Ce qui explique que les Inuits survivent au Groenland lorsque les Vikings sont obligés d’en partir.
Nous devons procéder à une nouvelle révolution symbolique pour pouvoir penser le monde.
Concrètement, en ce qui concerne la pandémie, comment le traduiriez-vous ?
Les conséquences de la pandémie de la Covid-19 ne sont pas imputables au seul virus mais dépendent des sociétés qui en sont affectées et ne s’y sont pas préparées. Ce qui veut dire qu’elles ont continué à s’organiser et à vivre selon des principes cognitifs et moraux, symboliques et sociaux totalement inadaptés. Et pour cause, c’est la thèse de mon livre, nous continuons à nous éclairer à la lumière d’astres morts, ceux de la fin du XIX
e siècle ! Il nous faut interpréter nos craintes d’effondrements, nos discours collapsologiques comme un savoir inconscient : un effondrement a déjà eu lieu, celui de nos catégories mentales et sociales. Nous nous refusons à voir que nous courons dans le vide en ayant depuis longtemps quitté le sol sur lequel nous étions. C’est incontournable : nous ne guérirons de cette crainte de l’effondrement futur qu’à la condition d’avoir le courage de faire le deuil de ce système symbolique perdu, obsolète et d’en penser un autre. Nous devons procéder à une nouvelle révolution symbolique pour pouvoir penser le monde, les autres et nous-mêmes, mettre en sépulture le « vieux » monde perdu, celui de la sécurité et du progrès, faire le deuil de ces mirages du XIX
e siècle pour pouvoir faire face à l’instabilité du monde actuel et à la contingence de ses événements. Nous devons entrer dans une nouvelle ère quantique, celle de la pensée.
Vous invitez à prendre acte de cet effondrement, que suggérez-vous en premier lieu ?
Pour pouvoir prendre acte de cet effondrement, qui est d’abord celui d’une défaite dans la vie de l’esprit (Hannah Arendt), il nous faudrait repenser le passé, ce passé qui ne « passe pas », qui se répète. La philosophie de l’histoire, avec Walter Benjamin, comme la psychanalyse avec Freud, nous apprend que le salut procède d’une capacité à se remémorer le passé sous une forme actuelle. L’Histoire permet un diagnostic du présent. Nous n’en sommes pas à notre première transition épidémique, le professeur d’histoire de l’université d’Oklahoma Kyle Harper a mis en évidence les facteurs environnementaux, les maladies infectieuses, dans la chute de l’Empire romain. La remémoration n’est pas le souvenir, elle est la proposition de revisiter ce signal de l’histoire au moment d’un danger, pour en comprendre les enjeux actuels ; elle en conditionne le sauvetage.
Nous avons depuis assez longtemps quitté le sol des utopies du XIX
e siècle, sur lequel nous continuons à bâtir notre vision du monde. Il nous reste à trouver le lieu d’un atterrissage, où nous pourrions vivre ensemble, heureux.
3 points à retenir
1. Sortir d’un système fondé sur l’évaluation quantitative et formelle, qui transforme les actes de nos vies en chiffres, en marchandise, et en spectacle. Reconsidérer la valeur de la parole, et accorder davantage d’importance aux œuvres de littérature et aux fictions, qui nous permettent de nous réapproprier notre capacité de penser et d’élaborer les conditions d’une nouvelle démocratie.
2. Il nous faut tirer profit du passé, moins pour le commémorer ou le placer dans des musées que pour en tirer une leçon à même de permettre un diagnostic du présent. On se rend compte que l’expansion territoriale des Romains s’est accompagnée également d’épidémies, qui ont participé à la chute de l’Empire, ce qui nous donne des indications sur la situation actuelle.
3. Le paradigme pasteurien est épuisé. Les maladies infectieuses ne sont pas seulement produites par les microbes (virus, bactéries, prions...), elles résultent de l’interaction de ces microbes avec leurs hôtes humains et animaux (zoonoses). Ce sont nos modes de vie qui en sont en partie responsables (modification du biotope) ; il est impératif d’en changer et d’en finir avec la productivité. Il faut que nous soyons en capacité « politique », c’est-à-dire citoyenne, d’enrayer les désordres écologiques, en stoppant la surexploitation de la planète et des humains.