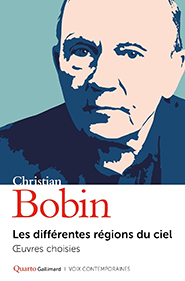C’est l’histoire d’un rendez-vous manqué. «
Ne m’en voulez pas mais je suis dans un silence indispensable pour regarder les nuages devant la fenêtre. Pour combien de temps. Plusieurs mois sans doute. L’écriture vient de là. J’ai vu votre travail et je sais que vous comprendrez », m’avait écrit Christian Bobin, suite à ma demande d’interview. Les mois se sont mués en éternité, par la force des choses : l’effraction de la mort, le 23 novembre 2022, des suites d’un cancer qui l’a foudroyé à 71 ans.
Cette mort qui traverse son œuvre, cet homme de foi, plus que d’Église, la percevait comme une métamorphose. Un sacre. Il écrivait de la vie qu’elle est
«
la petite classe de l’éternel », soulignant que seules deux choses viendraient à lui manquer dans l’éternité : «
Ce sont les livres et les lettres. » Alors, lui écrire… Encore et à jamais.
Lettre à un éternel poète
Cher Christian Bobin, permettez que je m’adresse à vous pour combler ce vide, dont vos écrits dépeignent si bien toutes les nuances… Votre corps n’est plus, mais votre cœur demeure, ainsi que vous le disiez de
La plus que vive, l’amoureuse disparue trop tôt, en 1995, à qui vous avez dédié quelques-uns de vos plus beaux livres. Comme notre entretien ici-bas n’aura pas lieu, c’est donc dans cet «
invisible qui semble donner le sens de toute chose » que nous deviserons des « différentes régions du ciel
(1) », de la brûlure de l’absence ou encore de l’éblouissement des
« chemins de l’encre » que vous avez tant dévalés. Tous ces essentiels qui participaient de vos nuits et de votre lumière vous survivent désormais à travers vos mots, sachant si bien extraire le merveilleux des petites choses et le suc du sacré. Cette lettre que vous m’avez adressée d’une belle écriture manuscrite, penchée comme un roseau dans le vent, en dit long sur vous ! Elle calligraphie les pleins et les déliés du contemplatif né que vous étiez, amoureux du ciel et du silence. Vous résidiez volontairement en marge des cercles littéraires et abhorriez «
les ordres de la vie moderne », vivant à contre-courant de vos contemporains. «
Dans la fluidité de l’électronique, on ne meurt plus jamais. Mais on ne vit plus non plus. » Ainsi, pour m’entretenir avec vous, il m’avait fallu envoyer un courrier. J’avais alors renoué avec
les délices de l’ouverture fébrile de la boîte aux lettres. Certes, votre réponse reportait
sine die notre rencontre, mais sa délicate poésie, tout à votre image, m’avait mise en joie. Il me suffisait d’attendre… Certains poètes, parce qu’ils frôlent de leurs fulgurances l’infini, nous semblent immortels. Votre mort m’a donc saisie, sidérée même, ainsi que tous ceux qui attendaient vos livres comme une pluie dans la sécheresse de notre monde. «
Personne ne peut m’arrêter maintenant. J’ai des ailes »,
concluiez-vous dans
Le Christ aux coquelicots…
Dans la fluidité de l’électronique, on ne meurt plus jamais.
Mais on ne vit plus non plus.
Berceau d’acier et plume céleste
Remonter le fil de votre destinée permet de tamiser le terreau de l’écrivain singulier que vous incarniez… du moins aux yeux de vos lecteurs, car les critiques n’ont pas toujours été amènes avec votre écriture finement spirituelle, que certains associaient à de l’angélisme. Benjamin d’une fratrie de trois enfants, vous êtes né au Creusot le 24 avril 1951, dans la mémoire encore vive des années de guerre. Fils d’un dessinateur industriel (un repère) et d’une mère calqueuse, tous deux employés à l’usine sidérurgique Schneider, vous écriviez dans
Prisonnier au berceau qu’à votre naissance, on vous a couché dans un berceau de fonte, un demi-obus. Toute votre vie, vous resterez viscéralement attaché à cette ville à l’âme métallique : «
Dans ma vie, j’ai bougé de 15 kilomètres tout au plus ! » C’était en 2005 pour vous installer avec la poétesse Lydie Dattas dans votre maison du « Champ Vieux », en lisière de forêt. Peu avant votre mort, vous êtes retourné à la source, dans un appartement au cœur du Creusot, cité maintes fois honorée dans vos écrits. «
Son fer est rentré dans mon âme », justifiiez-vous. «
Il n’y a rien ici, ni église baroque, ni demeures somptueuses. Il n’y a que les saisons qui passent, enflammant de leurs couleurs les jardins ouvriers. » Et c’est ce rien qui ouvre au Tout qui va vous inspirer : dans ce creuset alchimique où vos ancêtres forgeaient l’acier, vous apprendrez à forger des mots. Mieux, vous les cisèlerez. Pour arriver à la quintessence et toucher le cœur. «
J’ai préféré aller vers ce qui semble ignorer le passage du temps : les fleurs, l’amour dans sa première timidité, l’attente, la beauté d’un visage, le silence, la longue durée… » D’une plume céleste, vous laissiez s’envoler des phrases courtes, telles des fulgurances de lumière.
«
Le poète perce quelques trous dans l’os du langage pour en faire une flûte. Ce n’est rien mais le rien parle de l’éternel », peut-on lire dans
L’homme-joie. On
ne s’étonnera pas que vos livres, louant la beauté de l’impermanence, aient connu un réel succès au Japon, adoubés par les maîtres zen.
Un rire atomique
Mais avant cette éclosion, il y a eu votre genèse, solitaire : «
J’ai été seul pendant deux mille ans – le temps de l’enfance. De cette solitude, personne n’est responsable. Je buvais du silence, je mangeais du ciel bleu. » Cette solitude ouvre aussi à l’invisible : «
Est faussement réputé solitaire l’enfant qui prend conscience d’être entouré de présences innombrables, des fantômes avec lesquels il s’entretient sans phrases… » Précocement, vous dévoriez déjà les livres. Le jeune Hans Brinker, héros du livre
Les patins d’argent, qui sauva son village de l’inondation en colmatant une brèche avec son doigt, vous a-t-il inspiré ?
Toujours est-il qu’à cinq ans, d’un coup de marteau, vous aviez fait un trou dans le mur de
votre chambre… pour pouvoir le reboucher ?! Sauver symboliquement l’humain de la « noyade » : voilà peut-être le projet inconscient de votre écriture… Plus tard, des études de philosophie vous font découvrir Platon, Spinoza, Kierkegaard, mais aux concepts, vous préfériez la flamme ardente de la poésie. Brièvement élève infirmier à l’hôpital psychiatrique de Besançon, vous avez démissionné au bout de quinze jours, parce qu’on vous reprochait d’être trop chaleureux… Avant de pouvoir
vivre de votre plume, vous avez œuvré à l’écomusée du Creusot. Votre premier ouvrage,
Lettre pourpre, sort en 1977.
Souveraineté du vide, L’enchantement simple, La part manquante, Éloge du rien, Une petite robe de fête, La plus que vive, Autoportrait au radiateur, La nuit du cœur, L’homme qui marche… Ce sont près de soixante ouvrages traduits dans quarante langues qui continuent leur vie sur terre. Des livres dont les titres poétiques se murmurent entre lecteurs. Tenez, il y a quelques jours, par une heureuse synchronicité, j’ai assisté dans le train à une scène surréaliste pour l’époque : au milieu des voyageurs le nez sur leur écran, une femme s’est mise à parler à son voisin, lui partageant l’émerveillement d’avoir découvert
L’homme-joie, conseillé par une amie. C’est le miracle que produisent vos livres : ils ramènent de l’humain dans la froideur du monde. Voir ces passagers ainsi s’animer vous aurait sûrement fait rire ! De ce « rire atomique » qui vous caractérisait, et dont Lydie Dattas disait :
«
Cette bombe adorable projette en explosant des fleurs de feu, et des boulons de soleil. »
Le monde au bout du soulier
Si vous avez toujours préféré vous effacer derrière vos écrits, c’est avec
Le Très-Bas, publié en 1992 et consacré à la vie de François d’Assise, que vous avez atterri en pleine lumière, avec plus de 400 000 exemplaires vendus et plusieurs prix à la clé. Votre rencontre, par la grâce romanesque, était inévitable : vous partagiez avec le
Poverello une proximité d’âme, une vie «
radieuse de n’être rien ». Poètes, artistes et autres musiciens, ils sont nombreux à avoir nourri votre vie, votre œuvre : Glenn Gould, Yehudi Menuhin, Antonin Artaud, Ernst Jünger, Saint-Exupéry, André Dhôtel, Jean Grosjean, Joseph Conrad ou encore le poète russe Ossip Mandelstam, pour ne citer qu’eux. On les retrouve en filigrane de vos écrits… Il y a aussi Pierre Soulages, l’artiste de l’outrenoir, le maître des vitraux de l’abbatiale de Conques, devenu votre ami. Au point de lui dédier un livre, en 2019, sobrement intitulé
Pierre,. Votre passion commune pour la nuit et la lumière vous avait réunis : peut-être continuez-vous à en parler de l’autre côté du voile, puisque vous êtes morts à un mois d’intervalle ? Mais celle dont vous vous sentiez artistiquement le plus proche, c’était Emily Dickinson, cette poétesse américaine qui a si bien dépeint le
monde, en ne quittant quasi pas de sa chambre :
«
Oses-tu voir une âme en incandescence ? Alors blottis-toi sur le seuil », exhortait-elle. Votre ouvrage
La dame blanche était consacré à « la secrétaire des anges », comme vous la surnommiez. «
Bien avant d’être une manière d’écrire, la poésie est une façon d’orienter sa vie, de la tourner vers le soleil levant de l’invisible », écriviez-vous, allant au cœur de ce qui vous rassemble, voyageurs immobiles entre les dimensions, vagabonds entre les ciels. «
Quand je veux voir le bout du monde, je regarde le bout de mes souliers », ironisiez-vous. Le livre d’émerveille que vous aviez publié en 1996 avec votre alter ego photographe, Édouard Boubat, titrait
Donne-moi quelque chose qui ne meure pas… Je conserve le soleil invincible de votre poésie.
L’écho de l’invisible
« Les poètes meurent au combat même quand ils meurent dans un lit. Ils livrent bataille toute leur vie. » Tendu de son vivant vers l’au-delà à travers ses écrits, Christian Bobin a rendu son dernier souffle après avoir posé le point final à son livre ultime, Le murmure, publié en janvier dernier dans la collection Blanche, chez Gallimard. Commencé chez lui, au Creusot, en juillet 2022, poursuivi sur son
lit d’hôpital durant les deux mois précédant sa mort, le 23 novembre 2022, Le murmure appartient à ces œuvres extrêmes écrites dans des conditions extrêmes. À l’hôpital, l’homme au rire de tonnerre réalise à la lettre cette parole de Rimbaud : « Je suis de la race qui chantait dans le supplice. » Le murmure est la trace d’une course entre l’amour et la mort. Au bout du compte,
c’est l’amour qui gagne, faisant de ce chant un sommet d’humanité. Une ouverture plutôt qu’une fin : « On va vers des jours extraordinaires », épilogue Christian Bobin. « La fontanelle des morts se rouvre et tout l’univers que nous imaginions
au-dehors – lunes, oiseaux fabuleux, soleils, suppliques inaudibles et planètes orphelines – se réengouffre dedans. »
(1)
Les différentes régions du ciel, Œuvres choisies, Christian Bobin, éd. Quarto Gallimard,
2022.