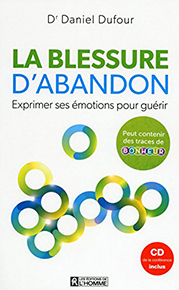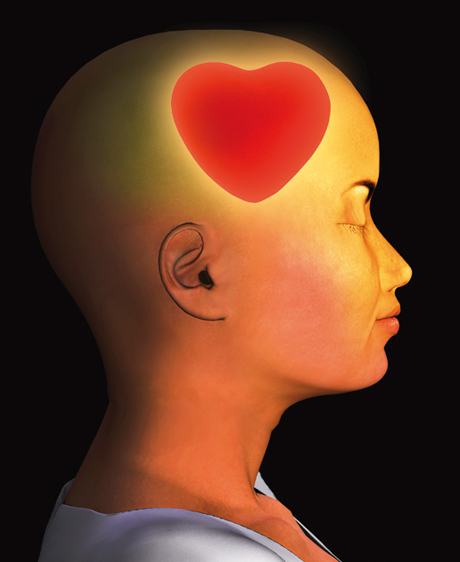Dans votre dernier ouvrage, Le bout
du tunnel, vous présentez le trouble du stress post-traumatique (TSPT). Pourquoi est-il si mal connu du corps médical,
comme des personnes qui en souffrent ?
Premièrement, c’est relativement récent, on a commencé à en parler avec le retour des vétérans du Vietnam dans les années 1970, mais leurs symptômes étaient classés dans « les troubles anxieux ». C’est seulement en 2013 que les Américains se sont rendu compte qu’il y avait plus que cela et ont créé le TSPT. Cela ne veut pas dire que la gent médicale n’était pas au courant, mais c’est un mal complexe parce que les manifestations sont très diverses et multiformes selon les gens. Du coup, le réflexe n’est pas de rechercher la cause des troubles, ce qui est malheureusement assez commun dans la médecine « classique ». Deuxièmement, on en a peu parlé dans les médias. Troisièmement, la plupart du temps, les personnes qui en souffrent se cachent. Et enfin, quatrièmement, on a attribué ces troubles aux soldats, mais pas aux policiers ni aux gardiens de prison ou au personnel soignant et encore moins aux personnes violées, abusées ou ayant vécu des catastrophes naturelles, alors qu’ils sont tous totalement victimes du TSPT. Avec ce qui se passe aujourd’hui concernant le harcèlement, c’est important de prendre conscience que le panel est plus large.
Vous l’avez étudié parce que vous en avez vous-même souffert ?
Oui, j’ai travaillé dans des pays en guerre et en rentrant en 1987, ce trouble est apparu, mais je ne savais pas de quoi je souffrais. Les deux psychiatres qui m’ont beaucoup aidé ne le savaient pas non plus. C’est en accompagnant moi-même des patients dans ma nouvelle pratique que j’ai compris d’où venait mon mal. Petit à petit, j’ai mis au point une méthode pour le soigner. Ce
n’est pas simple, mais faisable d’en guérir et non pas
juste survivre avec, ou en amoindrir les symptômes.
Vous distinguez deux types de maladies :
la maladie fatalité et la maladie message…
Il est important d’aborder sa guérison en fonction
de cela. Le concept de la « maladie fatalité », celui
de la médecine classique, ou de l’approche matérialiste,
va chercher à traiter les symptômes et
non pas leurs causes. On a un virus ou une cellule
anormale pour un cancer, on pose un diagnostic
et on va lutter contre. Cela explique les traitements.
Mais on ne va pas chercher à comprendre
ce que le corps délivre comme message à travers
la maladie. Alors que notre corps, qui est notre
meilleur ami, essaye de nous dire « écoute, tu fais
quelque chose de faux avec toi-même ». Il s’agit souvent
de la négation de sa propre personnalité ou
de la négation de ses émotions.
La colère
est souvent
perçue comme
négative.
Vous avez créé la méthode
OGE (à l’envers de l’EGO).
En quoi consiste-t-elle ?
Il est important de définir l’ego,
ou le mental, qui n’a strictement
rien de positif, dans le
sens où sa première caractéristique
est de nous couper du moment
présent.
C’est-à-dire qu’il
nous place soit dans le futur avec les
appréhensions, les peurs, les anxiétés,
les angoisses, la perte de confiance en soi
que cela génère (et souvent on ressent déjà une
tension dans le corps), soit dans le passé avec les
culpabilités, les remords, les regrets... Le premier
« pilier » de ma méthode, que l’on retrouve dans
toutes les bases de méditation depuis des centaines
d’années, est de porter son attention sur
son corps physique et sensoriel pour revenir dans
« l’ici et maintenant ». Mais ce n’est pas parce
qu’on revient dans le moment présent qu’on est forcément bien. Dans ce cas, on
est face à la deuxième caractéristique
du mental : on est coupé de
ses émotions. Le deuxième pilier de
la méthode OGE va donc être de reconnaître
que l’on a une émotion et de la
ressentir pour pouvoir ensuite la vivre, parce que
cela ne fonctionne pas du tout si on la ressent sans
pouvoir la vivre. Enfin, la troisième caractéristique
du mental, ou de l’ego, c’est de nous couper
de la personne que nous sommes : notre enthousiasme,
notre spontanéité, notre créativité, notre
noyau fondamental qui nous relie au « tout », à
l’univers. Le troisième pilier de la méthode sera
donc de nous reconnecter avec qui l’on est.
Concrètement, comment faire
pour éteindre le mental ?
C’est simple à expliquer, mais difficile à mettre
en pratique. Cela peut être de bouger ses orteils,
d’être attentif à la flexion de ses pieds ou à l’eau
qui coule sur notre corps quand on se douche, ou
cela peut être le fait de sentir l’odeur du café le
matin, ou de toucher son stylo. Bref, c’est porter
attention à quelque chose qui nous relie à notre corps physique et sensoriel. Et ce n’est pas en le
faisant qu’une fois par jour que cela marche, mais
10, 100, 1000 fois… Les gens disent qu’ils n’ont
pas le temps, mais ce n’est pas une méditation à
part entière, juste une attention portée à l’un de
nos sens, en évitant la vue parce qu’elle génère
70 % des pensées…
La deuxième phase de votre méthode
consiste à exprimer ses émotions.
Est-ce avec le thérapeute que cela se passe ?
Non, pas forcément... Dans le cadre du TSPT,
pour des personnes sévèrement atteintes, il vaut
mieux être accompagné par un thérapeute, oui,
mais cela peut se faire sans. Si l’on parle d’une
approche de la maladie, quelle qu’elle soit, cela
peut se faire seul chez soi. Par exemple, la colère
est une émotion mal aimée, souvent considérée à
tort comme négative. Ce qui est négatif, c’est de
la bloquer. Elle peut être libérée en hurlant
dans son oreiller chez soi ou en criant
dans sa voiture, ou dans la nature
en tapant sur une souche d’arbre,
mais l’expression doit être physique,
en ouvrant la bouche. Les
pleurs aussi doivent être « vrais »,
comme font les enfants… La
joie qui s’exprime doit être
au-delà du « je suis content »,
ce sont des rires, quelque chose
de physique. Cette libération se fait
pour soi- même, et non pour les autres
ou à l’encontre des autres.
Notre corps
est notre
meilleur
ami.
Il faut donc exprimer l’émotion sur l’instant
et ne pas chercher à l’expliquer ?
Oui, mais sur l’instant ce n’est malheureusement
souvent pas possible. Si vous êtes en colère contre
votre patron, vous ne pouvez pas lui hurler dessus.
Il va falloir différer. Pour cela, il faut éteindre
le mental et revivre la scène jusqu’au moment
où vous auriez eu envie de hurler, de pleurer ou
de rire, faire un arrêt sur image à ce moment-là
pour bien ressentir l’émotion bloquée, ce qui est
loin d’être agréable, et ensuite l’exprimer pour soimême
afin de se faire du bien.
Dans l’un de vos livres, vous parlez du concept
de pensée créatrice. Quelle est sa force ?
La pensée créatrice, c’est quand on a accès au troisième
pilier de la méthode OGE, à la personne
que nous sommes avec notre créativité, notre enthousiasme,
notre inventivité. Se dire « de quoi
ai-je envie, dans ma vie, que mettre en place ? »
et non pas « que faut-il que je fasse… », mais ce
n’est pas quelque chose qui va forcément passer
par le cerveau, même si cela passe par l’élocution.
Cela vient d’une partie en soi. Si on réfléchit en
termes de physique quantique, c’est explicable : on
va, dans l’infini des probabilités du monde quantique,
en puiser une pour la faire sienne. Par
exemple, « j’ai envie de guérir » et non
pas « il faut que je guérisse pour mes
enfants ». Je pose cette question
aux patients qui viennent avec
des pathologies lourdes, même
si ce n’est pas facile : « Est-ce que
vous avez envie de vivre ? » et très
souvent les réponses ne sont pas
positives…
C’est une question
difficile parce qu’elle ramène la
personne à elle-même. En majorité,
on me répond « évidemment j’ai envie
de vivre, sinon je ne serais pas chez vous… »,
mais quand je demande « oui, mais pour qui ou
pour quoi ? », eh bien j’obtiens tous types de réponses
: « pour mes enfants, pour les autres », mais
rarement « pour moi » ! La pensée créatrice, c’est
se ramener à soi-même en étant au centre de sa
vie et non dans la personne « fonction » (le père,
le métier) afin de sentir de quoi j’ai envie et non
d’être limité à ce que je dois faire pour assumer
mes fonctions correctement. Mais cela ne peut
arriver qu’à partir du moment où l’on a éteint ce
fichu mental. Après, le plus difficile est de rester
dans le moment présent et non d’être dans l’attente
de la matérialisation. Parce que malheureusement,
le réflexe souvent consiste à se mettre dans l’attente
que cela se matérialise. Du coup, que reçoit-on ?
De l’attente…! Il faut être dans le moment présent,
sans être dans l’attente. On n’a aucune prise sur la
matérialisation. Elle viendra on ne sait pas quand,
mais on peut la freiner en étant dans l’attente.