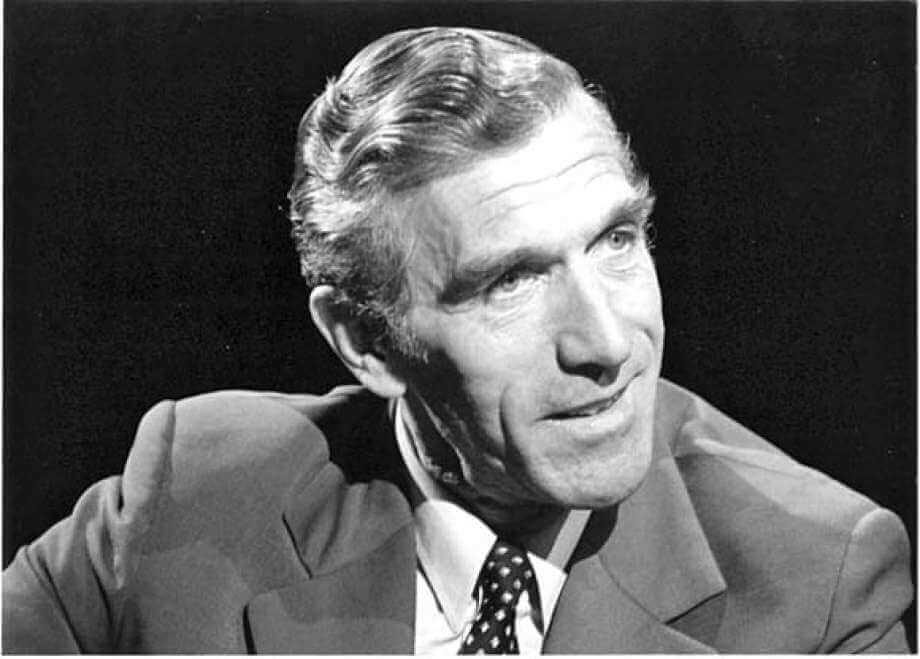Une fois n’est pas coutume, nous tirons ici le portrait d’une école, et non d’un individu !
Cette vraie « personnalité » se prête
bien à l’exercice : malgré son interdisciplinarité qui éclabousse tous les champs des relations humaines, elle jouit d’une identité forte, au point de s’ériger en nom générique, l’« École de Palo Alto », apte à recouvrir toute la complexité de ses domaines de recherche et d’intervention (thérapie, psychiatrie, communication, informatique, analyse des organisations, etc.). Quelques expressions frappantes sont devenues de véritables
punchlines, notamment « on ne peut pas ne pas communiquer », « le problème, c’est la solution », « empêcher le patient de se soigner ».
Mais cette école n’en est pas une, au sens scolaire du terme ; elle s’inscrit dans la lignée philosophique de cette étiquette. Auberge espagnole selon les uns, carrefour d’échanges hautement créatif selon les autres, l’école de Palo Alto désigne un courant de pensée né au milieu du XX
e siècle, au soleil de Palo Alto. Cité californienne connue pour abriter l’université Stanford et nombre d’entreprises de la tech. Dès le départ, cette « école » a regroupé des chercheurs appartenant à des disciplines plurielles, réunis par une vision systémique.
Connue pour être à l’origine de la thérapie brève et avoir fait prospérer la thérapie familiale, l’école de Palo Alto s’articule dès l’origine autour d’un fil rouge : nous sommes intrinsèquement des êtres d’interaction, tisserands de liens. C’est dans le tramage complexe de nos relations (familiales, professionnelles, sociales, institutionnelles) que naissent nos comportements, nos problématiques autant que leurs résolutions. Cette approche systémique et interactionniste des phénomènes humains – «
cet art fascinant qui consiste à résoudre des problèmes humains compliqués au moyen de solutions apparemment simples. Et à découvrir comment derrière ces “solutions simples” réside une théorie complexe et innovante », résumait Paul Watzlawick – signe l’essentiel du projet « paloaltien ». «
Cette perspective a littéralement révolutionné les sciences de l’homme et de la société. Elle a bouleversé les paradigmes et modèles antérieurs, dont beaucoup, de ce fait, sont devenus caducs », soulignent Dominique Picard et Edmond Marc, auteurs de
L’école de Palo Alto.
La structure qui relie
Si l’on rembobine succinctement la généalogie de Palo Alto, cette école s’épanouit dans le contexte de l’après-guerre qui voit naître de nouvelles disciplines scientifiques, notamment la cybernétique, formalisée par Norbert Wiener vers le milieu du XX
e siècle. «
C’est elle qui a permis de mieux comprendre comment chaque être humain est constamment façonné par ses interactions avec le monde (physique, social et culturel) qui l’entoure », précise Jean-Jacques Wittezaele, fondateur de l’Institut Gregory Bateson de Liège qui cosigne
À la recherche de l’école de Palo Alto. D’une approche linéaire, propre à la vision réductionniste et cartésienne, on en vient à une causalité circulaire et aléatoire, pour rendre compte de la complexité du vivant. Les principes de cette interaction dynamique dans tous les domaines de la société seront définis par la théorie des systèmes (Ludwig von Bertalanffy), ouvrant la voie à la systémique qui impactera tant les découvertes technologiques (dont Internet) que les sciences humaines. Ce courant est porté par les fameuses « conférences Macy ». Celles-ci réuniront à intervalles réguliers, de 1942 à 1953, des mathématiciens, logiciens, anthropologues, psychologues et autres économistes, en vue d’édifier une « science générale du fonctionnement de l’esprit ».
Ces échanges influenceront celui qui posera la première pierre, angulaire et symbolique, de l’école de Palo Alto, Gregory Bateson. Paul Watzlawick, qui rejoint plus tard cette aventure de l’esprit, disait de Bateson que son immense culture en faisait un véritable « homme de la Renaissance ». «
Depuis sa première recherche ethnographique, Naven(1), Bateson œuvre à la fois comme un biologiste passionné, un anthropologue de terrain novateur et un épistémologiste en quête de la “structure qui relie” », analyse Sandrine Chalet, auteure de
Découvrir l’école de Palo Alto et fondatrice du centre Change, spécialisé dans l’approche systémique et stratégique de Palo Alto. Ce chercheur-défricheur élèvera son questionnement jusqu’au sacré qui nous relie à la toile du monde. «
Bateson était à la recherche d’une sorte de matrice qui unit tous les êtres vivants », précise Dany Gerbinet dans
Le thérapeute et le philosophe (éd. Enrick B.). Ainsi, Bateson s’interrogera dans
Vers une écologie de l’esprit : «
Quelle est la structure qui relie le crabe au homard et l’orchidée à la primevère ? Et qu’est-ce qui les relie, eux quatre, à moi ? Et moi à vous ? Et nous six à l’amibe, d’un côté, et au schizophrène qu’on enferme, de l’autre ? »
Cet art fascinant qui consiste à résoudre des problèmes humains compliqués au moyen de solutions apparemment simples.
Du projet Bateson à
l’école de Palo Alto
À la sortie de la guerre, après sa
séparation avec l’anthropologue
Margaret Mead, il collabore avec Jurgen Ruesch, psychiatre et psychanalyste américain. Ensemble, ils étudient la communication et les relations interpersonnelles en psychothérapie, jusqu’à publier en 1951 le premier ouvrage qui transpose les concepts cybernétiques aux sciences humaines,
Communication, the Social Matrix of Psychiatry. Bateson obtient alors en 1952 un financement de la fondation Rockefeller pour un projet de recherche : « le projet Bateson », dans lequel il souhaite étudier l’effet des paradoxes sur le comportement. Gregory Bateson réunit une équipe au sein du Veterans Administration Hospital de Palo Alto (où il enseigne l’anthropologie et mène ses recherches), composée de l’anthropologue John Weakland, du psychiatre William Fry et de Jay Haley, étudiant en communication à Stanford. L’école de Palo Alto est née... même si le groupe n’utilise pas cette dénomination qui s’est imposée par la suite.
En 1954, Bateson obtient un financement de la fondation Macy pour l’étude de la communication chez les schizophrènes. Cette même année, le psychiatre Donald D. Jackson, qui observe les troubles psychiatriques dans une perspective interactionnelle, rejoint le noyau dur. Leurs recherches les mèneront à publier un article, largement commenté, critiqué et encore très souvent cité : «
Vers une théorie de la schizophrénie », qui introduit le concept de
double bind. Cette double contrainte («
Sois spontané ! »), selon eux, fait le lit de la schizophrénie, mécanisme de défense pour faire face à ce contexte et ultime moyen de maintenir la cohésion du groupe en tentant d’assumer son incohérence. Cette équipe curieuse et éclectique s’intéresse à l’humour, au zen (ils rencontrent Alan Watts et D.T. Suzuki), ou encore à l’hypnose de Milton Erickson.
Le problème, c’est la solution
L’équipe du « projet Bateson » étant majoritairement composée de praticiens, ils se tournent tous, à l’exception de Bateson lui-même, vers l’application des concepts systémiques à la psychothérapie. Les chemins peu à peu se séparent... En 1959, Donald D. Jackson fonde le Mental Research Institute (MRI) à Palo Alto avec Virginia Satir et Jules Riskin ; il propose à Bateson de les rejoindre pour inclure le travail sur les paradoxes, mais Bateson décline (il quitte Palo Alto en 1963). Paul Watzlawick, Richard Fisch, Jay Haley et John Weakland intègrent le MRI et, en 1968, Richard Fisch crée le Centre de thérapie brève au sein du MRI, où le rejoignent Watzlawick et Weakland. Ensemble, ils développent l’approche clinique de Palo Alto, la grille d’intervention de la thérapie brève. Avec une notion centrale : la « tentative de solution » (
attempted solution), mettant en lumière que ce sont les solutions essayées par le patient pour résoudre le problème qui font qu’il se maintient, voire s’amplifie. Un jeu sans fin, où s’entremêlent les interactions pathogènes : l’enfant soumis à la pression parentale sera de plus en plus passif et opposant. D’où l’adage : « Le problème, c’est la solution. »
De ce concept phare découle un accompagnement atypique, une école de la provocation féconde. En effet, pour sortir le patient du cadre où les remèdes deviennent des poisons, il faut « empêcher le patient de se soigner », l’empêcher de s’enfermer dans de fausses solutions. Ainsi, un insomniaque peut avoir comme réflexe de réunir les conditions propices au sommeil : silence, obscurité, relaxation. Or, se forcer à dormir suffit à chasser le sommeil ! Dans une optique thérapeutique, on peut donc tourner le dos au bon sens : l’inviter à dormir le moins possible et occuper les heures libérées pour faire ce qu’il n’a pas le temps de faire. Paradoxalement, il finira dans les bras de Morphée... Les thérapeutes de Palo Alto ont fait preuve d’une incroyable créativité dans les techniques utilisées pour susciter le changement : le « recadrage » (à une femme abattue par son divorce, signaler que, comme elle se plaignait de son couple, la séparation offre une opportunité de changer de vie) ; la « prescription du symptôme » (proposer à un enfant énurétique de mouiller volontairement ses draps) ; les « rituels thérapeutiques » (mettre en place des comportements codifiés pour casser les codes délétères : proposer à une famille qui ne s’écoute pas de se réunir à une heure précise, avec un temps de parole minuté de cinq minutes pour chacun durant lequel personne ne peut interrompre), etc. Protéiforme et d’une vitalité hors norme, cette école de Palo Alto a essaimé un vaste héritage. De la PNL à l’analyse transactionnelle, des constellations familiales à la Gestalt-thérapie, de la complexité formulée par Edgar Morin à la psychomagie de Jodorowsky, entre autres, ils sont nombreux à être inspirés par cette approche « paloaltienne », cette vision systémique du monde. Féconde et transformatrice.
« On ne peut pas ne pas communiquer »
Cette citation de Paul Watzlawick, l’une des figures de proue de l’école de Palo Alto, est un axiome essentiel de la vision systémique. En cessant de mettre l’accent sur l’individu et en le déplaçant sur l’interaction, on passe de « l’homme psychologique à l’homme communiquant ». Ce qui fit dire à Watzlawick : « Nous soignons des relations, pas des gens. » L’enjeu est d’agir sur la communication par la communication. « Un système de communication s’établit dès lors que deux partenaires prennent conscience qu’ils sont entrés dans le champ de conscience réciproque », dixit Bateson et Ruesch(2). Une fois perçu, tout comportement prend valeur de message et revêt du sens : un regard peut être interprété comme une marque d’intérêt ou une menace, et son absence perçue comme du tact ou du désintérêt. Quoi qu’il en soit, la personne ne peut pas ne pas réagir (même inconsciemment). D’où cette « impossibilité à ne pas communiquer », concept-clé pour appréhender notre relation complexe aux autres et ce qui vient la troubler.
(1)
La cérémonie du Naven (éd. Minuit) préfigure l’approche systémique et son application en anthropologie. Bateson, qui analyse les rituels comme entretenant ou gérant les clivages sociaux, y décrit cet étrange rite mélanésien entre oncle maternel et neveu/nièce, au cours duquel les hommes se comportent en femmes et vice versa.
(2)
Communication et société, G. Bateson & J. Ruesch, éd. Seuil.