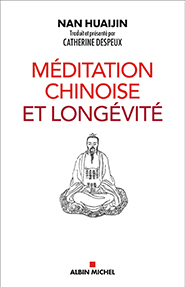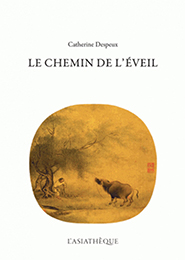Elle est l’une des plus grandes spécialistes du taoïsme. La sinologue Catherine Despeux met en lumière les mystères de l’alchimie taoïste, source d’incompréhension en Occident.
C’est jour de canicule. Le bitume fond, lorsque nous arrivons au paradis... Catherine Despeux nous accueille dans son havre de fraîcheur, noyé de verdure, au cœur de la Dordogne. Comme si elle avait réussi à déployer, en plein chaos climatique, cet équilibre fondamental, cher à la Voie du tao. Elle y a planté une forêt d’arbres et créé un antremonde, où l’immense bibliothèque peuplée d’ouvrages en chinois nourrit ses inlassables recherches. Elle nous reçoit dans une pièce fraîchement réaménagée dont la lumineuse sobriété fait écho au dépouillement qui est à l’œuvre au cœur de son être et de sa vie. Loin du tac au tac de notre époque au taquet, elle parsèmera notre entretien de silence. Pour mieux laisser « respirer » ses réponses, qui lèvent sans détour quelques énigmes et ambiguïtés sur la Voie.
Que signifiait être sinologue dans les années 1960-1970 ?
(Rire) C’était exotique ! Quand j’ai fait mes études, il n’y avait que l’Inalco (l’Institut national des langues et civilisations orientales) qui donnait des cours de chinois. À la fin de la troisième année, nous étions au mieux une quarantaine. C’était un peu fou de faire du chinois... et encore plus d’aller en Chine, puisque lorsque j’ai fini mes études, en 1967, c’était la Révolution culturelle. Le pays avait fermé ses portes aux étudiants. Je suis donc partie à Taïwan, où je suis restée quatre ans. J’y ai rencontré des bouddhistes, des taoïstes, et je me suis plongée dans la culture chinoise ancienne.
Directement par la pratique corporelle du tai chi et du qi gong?
Non, j’avais déjà commencé la pratique corporelle en France, en m’intéressant au bouddhisme, à la méditation, au yoga... Et j’étais allée chez Karlfried Graf Dürckheim qui enseignait le zen, en Allemagne. En arrivant à Taïwan, j’ai donc cherché des cadres qui me permettraient d’approfondir ces disciplines. On m’a conseillé le tai chi. Deux mois après mon arrivée, je suis allée vivre dans un petit temple bouddhiste, en montagne. Je n’y ai pas appris grand-chose parce qu’ils parlaient taïwanais, mais c’était un endroit merveilleux, où de la terrasse du temple on voyait le coucher de soleil se refléter dans l’eau... Un an après mon arrivée à Taïwan, j’ai rencontré Nan Huaijin, que j’ai suivi jusqu’à sa mort. C’était un lettré à l’ancienne qui avait appris par cœur tous les textes. En bon lettré chinois, ce maître éveillé faisait un syncrétisme des trois enseignements principaux, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme.
Les neurosciences s’intéressent, études à l’appui, aux bienfaits des arts énergétiques chinois (qi gong, tai chi...), notamment dans la protection du cerveau. « Scientiser » ces approches, les réduire au seul atout santé, n’est-ce pas les éloigner de leur essence, où la quête intérieure tient un rôle central ?
Ça ne me gêne pas, mais c’est une crainte. Selon moi, cette crainte ne concerne pas uniquement cette vision scientifique à laquelle on cantonne ces approches, elle touche aussi le sens que l’on veut insuffler à sa vie. En Occident, ces pratiques sont souvent présentées comme des techniques visant certaines prouesses, au détriment de la recherche plus intériorisée que ces arts impliquent. Autrement dit, le pratiquant fait telle chose, en vue d’obtenir tel résultat. Avec une attente en matière de bien-être et de confort physique, en oubliant quelle est, au fond, cette source de vie qui va œuvrer et s’exprimer à travers ces pratiques... C’est ce que j’ai trouvé très intéressant dans l’ouvrage de Nan Huaijin,
Méditation chinoise et longévité, que j’ai traduit : il part du physique, en mettant en lumière tous les effets psychophysiologiques dont on peut bénéficier en pratiquant régulièrement ces disciplines, faisant le lien avec les recherches scientifiques actuelles. Mais, petit à petit, il met l’accent sur le fait que le principal est ce qu’on appelle en chinois le
shen, traduit par « âme ».
L’alchimie est la science des transformations.
Qu’est-ce que l’âme, selon la vision chinoise ?
Ce mot « âme » peut prêter à confusion. Il faut lui enlever tout contexte chrétien. Le
shen est l’âme au sens où l’entendaient certains philosophes grecs et occidentaux, comme Descartes et Malebranche, qui ont parlé de corps, d’âme et d’esprit : le
shen est la lumière, la puissance spirituelle, associée à la fois au cœur, le centre de l’être, et au cerveau, avec la conscience et les pensées. Nan Huaijin amène donc peu à peu son propos vers cette dimension-là. L’ouvrage se termine avec des chapitres qui entrent dans le vif du bouddhisme chan (zen), quittant l’aspect physique pour se concentrer sur l’évolution des divers états de conscience et les pièges qui guettent le méditant dans sa progression vers l’Éveil. Voilà ce qui est en jeu dans toutes ces pratiques ! Tant qu’on en reste au niveau technique, on passe à côté de l’essentiel.
Le taoïsme et les pratiques associées à cette Voie mettent d’ailleurs l’accent sur l’alchimie intérieure. Quelle en est la teneur ?
Cette alchimie intérieure est un système très compliqué pour des choses très simples ! Cette terminologie attire beaucoup les Occidentaux, car elle est jalonnée de mots, de concepts, de pratiques à faire (visualisations, etc.). Au fond, que veut dire « l’alchimie » ? L’alchimie est la science des transformations. L’intérêt du taoïsme, mais aussi du yoga indien par exemple, c’est qu’ils considèrent qu’il ne faut pas séparer le corps et l’esprit. Tout travail, toute transformation du psychisme va donc se refléter dans le physique. Inversement, l’état physique aura une incidence sur le psychique. (...)